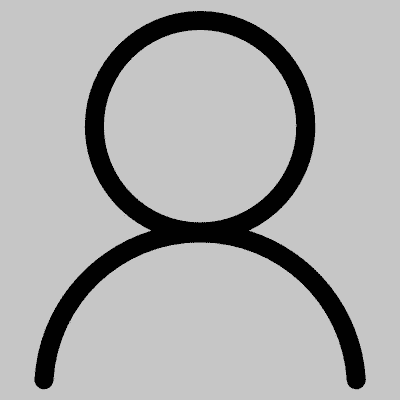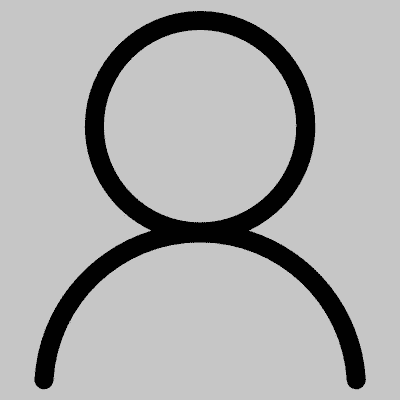About Me
PIERRE BOURDIEU (1930-2002)
ETHNOLOGUE, SOCIOLOGUE, PHILOSOPHE, GRAND PENSEUR DU XXème SIECLE.
Pierre Bourdieu occupait une position dominante dans la sociologie française et reste encore une des figures marquantes de la sociologie française. Agrégé de philosophie, il a d'abord été assistant à la faculté d'Alger avant de devenir, en 1964, directeur d'études de l'Ecole pratique des hautes études de Paris. Il crée en 1968 le Centre de sociologie de l'éducaation et de la culture, et en 1975 la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Il devient, en 1981, titulaire de la chaire de sociologie au Collège de France (ce qui ne se fera pas sans suciter des jalousies...).
Bourdieu insistera, tout au long de sa carrière, sur la rupture avec le sens commun, sur la nécessité pour la sociologie d'être reconnue comme une science comme les autres ; il ne variera pas quant à son exigence de mise en oeuvre de la rigueur scientifique dans la production de connaissances sociologiques.
Quelques éléments importants de son analyse :
Les individus sont des « agents » plutôt que des « acteurs » : Selon Bourdieu, il n'y a pas de sujet, d'acteur, d'individu conscient et calculateur, mais des actions sociales dont le sens échappe, au moins en partie, à celui qui les met en oeuvre. Le sociologue ne peut parler que d' « agents », qui sont autant « agis » qu'ils agissent.
Le vocabulaire : Il est important de clarifier un peu le vocabulaire bourdieusien (ou "bourdivin"...?). Dans un souci de précision et de meilleure restitution possible des phénomènes sociaux qu'il observe, il recourt en effet à un vocabulaire parfois complexe.
• Le vocabulaire importé de l'économie : L'économiste a introduit dans le langage courant les notions de « marché », d' « investissement », de « capital », de « concurrence », de "conversion". Bourdieu importe ces notions dans ses travaux sociologiques. Ainsi utilise-t-il les notions de capital culturel, social, économique, de profit, de rentabilité, de conversion des habitus, des capitaux, etc.
Capital économique : ensemble des ressources (revenus et partimoine) d'un ménage, qui lui permet de défendre (ou d'améliorer) sa position sociale.
Capital social : ensemble des facilités sociales (réseaux de relations, familiarité avec des modes de fonctionnement des lieux de pouvoir, etc.) qu'un ménage est capable de mobiliser à son profit. C'est donc l'ensemble des ressources auxquelles un ménage peut accéder grâce à ses relations sociales.
Capital culturel : ensemble des ressources et dispositions (= ce qui relève de l'appris via la socialisation) culturelles (biens culturels, accès à ces biens, diplômes, rapport à la culture et à l'école) dont dispose un individu ou un ménage.
Bourdieu introduit également la notion de « capital symbolique » qui désigne l'ensemble des « signes distinctifs et des symboles du pouvoir », acquis ou hérité par un agent. Cet ensemble inclut la respectabilité, l'honnorabilité et la réputation de compétence. Le capital symbolique est donc ce qui fait que les agents accordent une reconnaissance, un respect, une légitimité aux détenteurs des différentes formes de capitaux.
• Le concept d'habitus : L'habitus est défini comme « un système de dispositions acquises par l'apprentissage », « un système de dispositions durables et transposables » ; il s'agit donc d'un ensemble de dispositions intériorisées et incorporées par les individus au cours du processus de socialisation. L'habitus est donc que les individus ont acquis durant leur histoire individuelle.
Il existe aussi des habitus de classe : ensemble de dispositions et de pratiques communes à des agents qui ont vécu dans (et par conséquent ont intériorisé) les mêmes conditions d'existence du fait de leur appartenance à la même classe ou fraction de classe. Ainsi, « le sens de la distinction » est un élément constitutif de l'habitus de la classe dominante, « le sens de la nécessité » est, quant à lui, un élément constitutif de l'habitus des classes populaires.
Les classes sociales : Bourdieu a construit des classes sociales à partir de la classification des CSP. Il différencie la classe dominante, les classes moyennes et les classes populaires, en fonction du volume de capital que chaque groupe détient. Il décompose les deux premières classes en fractions de classes, en fonction de la structure du capital (c'est-à -dire de la composition du capital détenu : plutôt économique, plutôt social, plutôt culturel). Ainsi, dans la classe dominante, on trouve une fraction de classe dite dominante et une fraction de classe dite dominée. La fraction dominante possède plus de capital économique que de capital culturel, alors que la fraction dominée possède moins de capital économique que la fraction dominante mais un fort capital culturel. De la même façon, à l'intérieur des classes moyennes, on distingue une fraction de classe dite traditionnelle, et une fraction dite moderne, la fraction traditionnelle dominant la fraction moderne car elle possède un capital économique supérieur.
Les agents qui occupent une même position sociale ont un certain nombre de propriétés en commun, qui s'expliquent par des conditions d'existence semblables. Ils partagent un même habitus de classe, c'est-à -dire un système de dispositions qui homogénéisent leurs pratiquent et leur vision du monde.
L'école : Les deux livres que Bourdieu a écrit avec J.C. Passeron portant sur l'école (Les Héritiers, 1964, et La Reproduction, 1970) montrent que l'école contribue à la reproduction sociale et à l'accumulation du capital culturel pour les enfants des fractions de la classe dominante. En fait, la réussite scolaire tiendrait à l'homologie entre les habitus des enseignants et ceux des enfants appartenant aux familles disposant d'un fort capital culturel. L'institution scolaire légitimerait un capital culturel propre aux classes dominantes (notamment un langage légitimé par ces classes dominantes), et reproduirait donc les inégalités sociales, en sanctionnant positivement les détenteurs du capital culturel légitime, et négativement les autres.
Domination, culture légitime et culture illégitime : Bourdieu considère que les relations de domination entre les groupes sociaux prennent la forme d'une lutte symbolique. Il s'agit, pour les agents de la classe dominante, d'imposer une vision du monde conforme à leurs intérêts ce qui permet d'assurer la reproduction de l'ordre social : la culture dominante s'inscrit dans un processus de légitimation. Bourdieu utilise alors le concept d'arbitraire culturel pour montrer que le mode de légitimation de la culture bourgeoise ne repose sur aucun critère objectif : il n'est dû qu'à une situation de domination symbolique admise par les autres groupes.
Ce découpage de l'espace social en culture légitime et culture illégitime structure les pratiques sociales. Les membres de chaque classe élaborent des stratégies de distinction qui ont pour objectif d'affirmer la spécificité de leur culture. Il en découle une consommation de biens culturels très différenciée selon les groupes sociaux. Cependant, ces biens culturels font l'objet d'un classement autour de l'axe légitime / illégitime. Le domaine culturel est ainsi fondé sur une logique de classement hiérarchique allant du plus légitime au moins légitime (théâtre classique / théâtre de boulevard ; golf / football, opéra / variété...).
Selon Bourdieu, la classe dominante cherche à maintenir sa position de domination symbolique par des stratégies de distinction sans cesse renouvelées. Dès qu'une pratique jusque là réservée à la classe dominante se diffuse, la stratégie de distinction va mener à en substituer une autre.
"L'opinion publique n'existe pas" : Pour Bourdieu, tout le monde n'a pas une opinion sur tout et ce phénomène est d'ailleurs observable dans les pourcentages importants de non-réponses dans les sondages. Il souligne que le taux de non-réponses est plus élevé d'une manière générale chez les femmes que chez les hommes, et que l'écart est d'autant plus grand que les problèmes posés sont d'ordre politique. De façon générale, la probabilité d'exprimer une opinion dépend du niveau d'instruction et du degré d'engagement du sondé par rapport au domaine sur lequel il est interrogé.
Pour Bourdieu, l'enquête d'opinion traite l'opinion publique comme une simple somme d'opinions individuelles. Dans les situations réelles, la seule opinion qui compte est celle des groupes mobilisés (syndicats, groupes de pression...). Ainsi, l'opinion publique des sondages est "un artefact pur et simple dont la fonction est de dissimuler que l'état de l'opinion à un moment donné du temps est un système de forces, de tensions et qu'il n'est rien de plus inadéquat pour représenter l'état de l'opinion qu'un pourcentage". Les sondages n'ont ainsi qu'une fonction de légitimation des pouvoirs en place et "l'opinion publique n'existe pas", sous la forme en tout cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence.
"La jeunesse n'est qu'un mot" : "L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. Le fait de parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué, doté d'intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. Il faudrait au moins analyser les différences entre les jeunesses ; par exemple, on pourrait comparer systématiquement les conditions d'existence, le marché du travail, le budget-temps, etc., des "jeunes" qui sont déjà au travail et des adolescents (du même âge biologique) qui sont étudiants : d'un côté les contraintes, à peine atténuées par la solidarité familiale, de l'univers économique réel, de l'autre, les facilités d'une économie quasi-ludique d'assistés, fondée sur la subvention, avec repas et logement à bas prix, titres d'accès à prix réduits au théâtre et au cinéma, etc. Autrement dit, c'est par un abus de langage formidable que l'on peut subsumer sous le même concept des univers sociaux qui n'ont pratiquement rien de commun".
Le métier de sociologue selon Bourdieu : Dans de nombreux ouvrages, Bourdieu poursuit une réflexion épistémologique (l'épistémologie pouvant se définir comme une discipline qui se consacre à l'étude critique de la production et de la validation des connaissances scientifiques) dont le but est de renforcer la légitimité scientifique de la sociologie alors que celle-ci rencontre des difficultés à être reconnue comme une science à part entière. Dans cette optique, Bourdieu insiste sur la fait que le sociologue doit en permanence exercer une "vigilance épistémologique". Ce contrôle épistémologique est rendu possible par les procédures de corroborations empiriques (confrontation au réel). En outre, Bourdieu insiste sur le fait que la connaissance sociologique poursuit une logique de rupture avec le sens commun : "le fait est conquis contre l'illusion du savoir immédiat". Il rappelle que si cet énoncé est valable pour toute science, il occupe une place prépondérante en sociologie où "la séparation entre l'opinion commune et le discours scientifique est plus indécise qu'ailleurs". Un point qui a suscité des malentendus entre le travail de Pierre Bourdieu et le public français, lequel opérait une confusion entre jugement de fait et jugement de valeur. Ce qui fera dire à Bourdieu "il me semble qu'une cause majeure du malentendu réside dans le fait que l'on considère comme une prise de position normative sur le monde social quelque chose qui se pense comme une analyse positive de ce monde. (...) Bizarrement, au lieu de m'accorder le mérite de la découverte - au sens actif d'action de découvrir - on me fait reproche de ce qui se trouve ainsi découvert, révélé (...) Si on n'aime pas ma sociologie, c'est peut-être parce qu'on aime pas ce qu'elle révèle; parce qu'on ne veut pas voir les choses en face, comme elles sont." (Questions à Pierre Bourdieu, G. Mauger, L. Pinto, "Lire les sciences sociales", vol.1).
La sociologie permet de sortir de la "fatalité sociale" : un autre élément important dans le travail de Bourdieu a été justement de chercher à dévoiler ce qui est caché et ainsi permettre à ceux qui subissent les violences les plus subtiles (symboliques) de comprendre et sortir de la fatalité. Si la connaissance peut susciter un certain désenchantement, elle permet aussi de comprendre l'organisation de l'ordre social et ainsi de remettre en cause ce qui est souvent considéré comme "allant de soi". "Une part des souffrances sociales est justiciable d'un traitement social. Bien sûr, l'analyse ne fait pas à elle seule disparaître les causes sociales qui dépassent les individus, mais elle peut donner à ceux qui souffrent des moyens de maîtriser au moins la représentation qu'ils ont de ce qui leur arrive. C'est mon optimisme un peu scientiste, mais je pense qu'il vaut mieux savoir la vérité que de ne pas savoir, et qu'on peut fournir à des gens qui souffrent quelques moyens de comprendre un tout petit peu mieux ce qui leur arrive, au lieu de "déplacer" les problèmes, par exemple du côté du psychologique. (...) Beaucoup de sociologies charmantes sont le fait de marchands d'illusions qui tiennent des propos sans intérêt et sans conséquences. Au contraire, le fait de prendre les choses comme elles sont (selon moi en tout cas), c'est se donner un tout petit peu d'espoir réel. Le pense que je suis profondément optimiste en partie parce que, là où j'aurais eu tendance à voir les choses dans la logique du destin, de la fatalité sociale, etc., je vois de plus en plus des ouvertures fondées en partie sur la connaissance et sur le travail qu'elle permet" (Questions à Pierre Bourdieu, G. Mauger, L. Pinto, "Lire les sciences sociales", vol.1).
"Ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles au prétexte qu'elles sont intellectuelles, qu'elles sont écrites avec de grands mots" (La sociologie est un sport de combat, film de Pierre Carles) : Bourdieu a su montrer combien la violence, dans nos sociétés, s'exerce de manière subtile, discrète, cachée, et combien elle parvientà établir et perpétuer un ordre, une hiérarchie sociale. La sociologie devient alors une arme pour dévoiler la façon dont la violence symbolique s'exerce et remettre en cause cet ordre dont les fondements sont alors mis à nus, expliqués. Bourdieu notait à ce sujet : "Dans des sociétés comme la nôtre, où les phénomènes de domination prennent des formes de plus en plus sophistiquées, où on passe de plus en plus de violences
brutales, de type physique ou économique, à des violences douces, que j'appelle violences symboliques, violences qui s'exercent avec une sorte de complicité inconsciente de ceux qui les subissent, il est évident que la sociologie a un rôle absolument capital. Elle est peut-être une des seules défenses réelles contre la violence symbolique, dans la mesure où elle offre les armes pour rompre avec cette sorte d'accord immédiat des structures mentales et des structures sociales qui est le fondement de cette violence. Ce que décrivent les ethnométhodologues sans le savoir, c'est le phénomène politique fondamental, à savoir
l'accord inconscient que les agents sociaux accordent au monde dans lequel ils ont été produits" (Questions à Pierre Bourdieu, G. Mauger, L. Pinto, "Lire les sciences sociales", vol.1).
Bourdieu, le dernier des classiques ? Bourdieu représente la fin d'un programme de recherche : on dit alors parfois de lui qu'il est le dernier des classiques, car sa sociologie ne s'inscrit pas dans le type de recherches poursuivies aujourd'hui.
Comme tous les auteurs classiques, la sociologie de Bourdieu répond à 3 caractéristiques : 1) sa sociologie a l'ambition d'être une sociologie générale de la société (alors qu'aujourd'hui on note une tendance à la spécialisation et une renonciation à la construction d'une sociologie générale) ; 2) pour Bourdieu, la sociologie a une place spécifique par rapport aux autres sciences sociales (alors qu'aujourd'hui on note une tendance à l'hybridation, au décloisonnement des sciences sociales) ;
3) enfin, Bourdieu insiste sur la rupture entre le point de vue du chercheur et celui des agents (sens commun), en développant d'ailleurs une certaine méfiance vis-à -vis du point de vue de l'agent dont le discours est partiel et partial(ce qui est en décalage avec les axes récents de recherche en sciences sociales, notamment avec les travaux sur les capacités cognitives des acteurs sociaux).
La sociologie bourdivine conduit-elle à un pessimisme désenchanteur ?
Il a souvent été reproché à la sociologie de P. Bourdieu de donner une image "surdéterminée" de l'homme qui conduirait à une sorte de fatalisme rendant illusoire toute forme d'action politique. Au cours de ses travaux, Bourdieu a au contraire montré que les progrès de la connaissance sociologique, loin de conduite à un "pessimisme désenchanteur", créent les conditions d'une transformation de la société. "On confond souvent sous le mot de déterminisme deux choses très différentes : la nécessité objective, inscrite dans les choses, et la nécessité vécue, apparente, subjective, le sentiment de nécessité ou de liberté. Le degré où le monde social nous paraît déterminé dépend de la connaissance que nous en avons. Au contraire, le degré auquel le monde est réellement déterminé n'est pas une question d'opinion ; en tant que sociologue, je n'ai pas à être "pour le déterminisme" ou "pour la liberté" mais à découvrir la nécessité, si elle existe, là où elle se trouve. Du fait que tout progrés dans la connaissance des lois du monde social élève le degré de nécessité perçue, il est naturel que la science sociale s'attire d'autant plus le reproche de déterminisme qu'elle est d'autant plus avancée. Mais, contrairement aux apparences, c'est en élevant le degré de nécessité perçue et en donnant une meilleure connaissance des lois du monde social, que la science sociale donne plus de liberté. Tout progrès dans la connaissance de la nécessité est un progrès dans la liberté possible".
Principaux ouvrages : Les héritiers, 1964 ; Le métier de sociologue, 1968 ; La reproduction, 1970 ; La distinction, critique sociale du jugement, 1979 ; Le sens pratique, 1980 ; Choses dites, 1987 ; Les règles de l'art, 1992 ; La misère du monde, 1993 ; Raisons pratiques, 1994 ; Méditations pascaliennes, 1997 ; La domination masculine, 1998.
Un site à visiter : http://www.homme-moderne.org/societe/socio/bourdieu/index2.h
tml
Vous y trouverez des textes de Pierre Bourdieu.